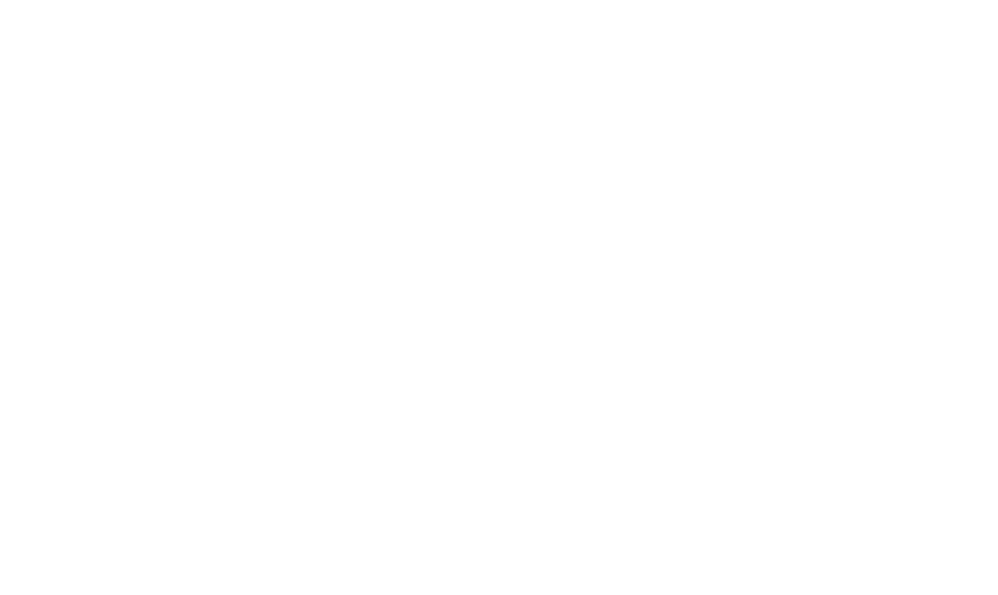Les iles de la basse Casamance face aux défis climatiques et au développement socio-économique
La basse Casamance, située au sud du Sénégal, compte vingt -et-une îles marquées par leur exposition et leur vulnérabilité à l’érosion et la remontée des eaux marines (Thior et al., 2021). Une situation accentuée par les effets du changement climatique et la nature de l’exploitation des ressources naturelles à en croire les travaux de Sy et al., 2018 et Diémé, 2018. Depuis quelques années, en raison de ces phénomènes marins (érosion et submersion) des hectares de terres agricoles et plusieurs mètres de côte ont été perdues. Selon Barry (2016) et Thior et al., (2020), un recul global de -5,85 m/an a été enregistré sur la plage de Diogué tandis qu’à l’île de Karabane, le taux de recul est de -0,60 m/an. Au sud de l’embouchure, entre Gnikine-Diembéring et la plage de Cap Roxo, les taux de recul sont respectivement de -3,30 m/an et -091m/an. A Kafah, dans l’île Karabane, le cordon de terre qui sépare l’océan de l’eau douce est fortement menacée par l’érosion alors que sa destruction pourrait provoquer directement une inondation de l’île. L’année dernière, à l’île de Gnikine, les champs de riz ont été impactés par la remontée des eaux entrainant des pertes de rendements. Autant de conséquences climatiques qui fragilisent la résilience, déjà très précaire, des insulaires, lesquels confrontés à plusieurs défis d’ordres socio-économiques.
L’agriculture, activité séculaire, qui a longtemps contribué à la sécurité alimentaire dans ces zones, est aujourd’hui menacée. Pourtant, elle motivé l’occupation de ces îles pour des populations qui cherchaient des terres arables[1]. Actuellement, le développement et la durabilité de cette pratique est très limitée par divers facteurs. La croissance démographique dans les îles engendre directement un besoin accru de logements sur des surfaces autrefois réservées à l’agriculture ; à cette expansion du bâtit, s’ajoute un recul du trait de côte sous l’effet de l’avancée de la mer. Parallèlement, l’eau et la terre subissent une salinisation progressive ’. Ces dynamiques, internes et externe, constituent les principaux facteurs de réduction des terres, rendant impossible la pratique de la culture du riz et des autres spéculations qui contribuaient à la sécurité alimentaire des communautés très isolées.
Alors que la population totale au niveau des îles a atteint plus de 8 000 habitants (GIZC, 2019), l’accès aux services sociaux de base notamment l’eau et l’électricité reste un défi majeur
Pour pallier à ce manque d’eau, les populations doivent se rendre à Elinkin (sur le continent) ce qui nécessitent plusieurs minutes de pirogue, pour se ravitailler avec des bouteilles de 20 litres payés à 400 FCFA l’unité (200 FCFA payer l’eau, 200 FCFA pour le transport) et utilisées de façon très rationnelle pour satisfaire leur besoin. A Gnikine, en l’absence d’infrastructures d’accès à l’eau potable, les populations collectent l’eau de pluie durant l’hivernage. Cette eau de pluie qui constitue l’unique source est stockée et utilisée durant toute l’année. Pourtant vers le début de l’hivernage (avril-mai-juin) les réserves d’eau sont épuisées et ces dernières peinent à en trouver. Pour ce qui est de l’accès à l’électricité, malgré quelques initiatives portées par des acteurs non étatiques pour éclairage public (au niveau de Diogué par exemple), les populations utilisent des kits solaires PV pour satisfaire leur appétit énergétique très croissant. Pourtant le coût d’accès à ces équipements reste une limite pour les ménages. Suivant les entretiens tenus avec les populations locales, aucun programme de l’Etat en termes d’électrification rurale ne concerne encore ces zones très enclavées.
Le développement des services sociaux de base ne suit pas le même rythme que la croissance démographique. Les infrastructures dédiées sont pour la plupart vétustes, sans toutes les commodités pour assurer des soins de qualité. A défaut de disposer d’un centre de santé capable de répondre aux besoins basiques des populations locales, certaines communautés sont obligées de transporter leur malade vers d’autres îles ou même à Ziguinchor, située à plusieurs kilomètres. Pourtant, certaines de ces terres ne disposent pas encore de pirogues motorisées pour faciliter ce transfert ; ce qui occasionne souvent des pertes en vies humaines en cours de route surtout de femmes en accouchement.
Recommandations :
Des solutions existent pour renforcer l’adaptation de ces communautés face aux impacts et menaces climatiques, et améliorer leur développement socio-économique.
- Encourager la souscription à des polices d’assurance agricole pour couvrir les risques climatiques qui affectent les rendements agricoles ;
- Appuyer le développement des épis maltais très efficace dans la récupération des terres érodées ;
- Construire des infrastructures de qualité (écoles, structures sanitaires, etc.) pour faciliter l’accès aux services sociaux de base ;
- Renforcer l’accès aux services énergétiques modernes afin de favoriser le développement d’activités économiques.
[1] : selon les populations enquêtées